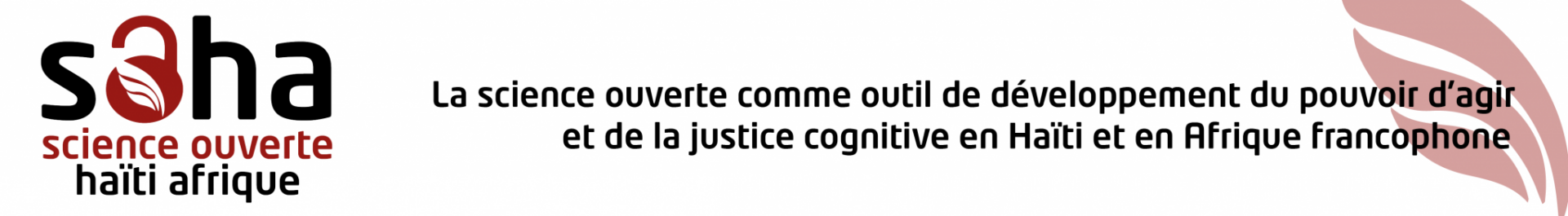Né à Baloum dans le Département de Menoua au Cameroun, Raymon Dassi a fait ses études élémentaires dans son village. Issu de la première génération d’élèves de l’après-guerre des indépendances, il a dû s’éloigner de son terroir vers des centres plus urbanisés au fur et à mesure qu’il avançait dans ses études : Bansoa, Bafoussam puis Yaoundé où il a obtenu son bac en philosophie et littérature en 1994. Il est installé en Italie depuis la fin des années 1990, dans la ville de Bologne où il vit maintenant. Passionné de journalisme et des langues, Raymon est aussi engagé dans la vie politique de son pays d’adoption. Il a ainsi exercé des fonctions de conseiller et d’adjoint au Maire dans sa municipalité de résidence. Il suit actuellement un parcours de recherche en communication publique.
***
À nous autres, Africains post-indépendants, nos États néocoloniaux avaient confectionné un parcours de formation qui avait pour but de nous conduire petit à petit vers une inexorable équivalence avec les Occidentaux. Notre approche de la connaissance, de la science, nous a ainsi été servie assortie du préalable de l’apprentissage de la langue des autres. Ceci s’est traduit, par exemple dans le pays bamiléké d’où je viens, dans les hauts plateaux de l’Ouest du Cameroun, par la nécessité pour tous les jeunes de se plier aux exigences de la langue de Molière, même pour espérer comprendre telle réaction chimique ou telle fonction mathématique.
Pourtant, 10+10 = 20, ça se savait déjà dans nos familles depuis des lustres. D’ailleurs, pour comprendre (c’est-à-dire prendre avec soi) les différentes fonctions mathématiques que nos enseignants s’éreintaient à nous transmettre en un français tout aussi hésitant, nous étions obligé de recourir, intérieurement, au calcul mental dans notre langue. Dans certains villages de l’Ouest du Cameroun, il n’est d’ailleurs pas exclu que l’enseignant lui-même, souvent livré à d’énormes difficultés de transmission et voyant les regards égarés de ses élèves à la suite d’une énième tentative infructueuse d’explication, ait eu recours à la traduction de certains concepts mathématiques en langue locale, pour enfin susciter un ouf de soulagement de ses élèves.
Quand nous commencions à étudier les principes des équations avec plusieurs variables, l’afflux de nouveaux concepts en langue française ne pouvait que faire perdurer des sensations d’handicap chez la majorité de nos camarades. L’invariable, le facteur, les extrêmes, les moyens : c’est quoi tout ça? C’est un cours de mathématique ou bien un cours de langue française? Comment exprimer ces concepts en Fèfè, en Yemba, en Ghomálá? Ne pas nous enseigner les notions scientifiques dans notre langue, c’était nous causer un grand tort, percevions-nous. On en était même arrivés à penser que les autorités néocoloniales, dont la longue chaîne commençait par nos enseignants et se terminait à la tête de l’État, sinon à Paris, ne voulaient pas nous faire comprendre les choses.
C’est alors que le peuple estudiantin a élaboré et appliqué des mécanismes de résistance. « On n’est pas venus sur cette terre pour les regarder faire, bon sang!!! ».
 L’enseignement officiel se faisait dans les établissements scolaires compétents pendant les horaires légalement établis. C’était l’école du gouvernement, de l’État, du blanc. On y allait en uniforme, bien rasé, presque anonymisés, alignés et toujours prêts à chanter, notamment l’hymne national: « O’ Cameroun, berceau de nos ancêtres »! On le faisait sans jamais oublier que le nom de notre pays, le Cameroun, vient hélas du mot portuguais camaroes, ou de l’espagnol camerones : crevettes!!! Ça, franchement parlant, ça ne nous arrangeait pas beaucoup! Mais bon, il fallait chanter, et nous chantions!
L’enseignement officiel se faisait dans les établissements scolaires compétents pendant les horaires légalement établis. C’était l’école du gouvernement, de l’État, du blanc. On y allait en uniforme, bien rasé, presque anonymisés, alignés et toujours prêts à chanter, notamment l’hymne national: « O’ Cameroun, berceau de nos ancêtres »! On le faisait sans jamais oublier que le nom de notre pays, le Cameroun, vient hélas du mot portuguais camaroes, ou de l’espagnol camerones : crevettes!!! Ça, franchement parlant, ça ne nous arrangeait pas beaucoup! Mais bon, il fallait chanter, et nous chantions!
Mais voilè qu’en dehors de ces sentiers officiels d’apprentissage, pleins de liturgies et d’autres protocoles, apparut une floraison de lieux dits de répétition. Le mot à lui seul mérite une analyse bien plus complexe. Qu’y répétait-on? Les leçons apprises à l’école, surtout les matières scientifiques : les mathématiques. Précurseurs des centres de formations privés qui existent aujourd’hui, les lieux de répétition étaient des chambres, des petites cours, des jardins, et souvent même, pour les plus téméraires, les salles de classe abusivement occupées le soir. Un groupe d’élèves se formait, dopo scuola, autour d’un expert en la matière : un aîné qui faisait les classes supérieurs; un enseignant officiel mal payé qui redispense, dans le maki et en langue locale, ce qu’il avait rapidement énoncé en classe; un volontaire qui se livrait à un jeu de prestige… Les lieux de répétition mettaient en scène la transmission de la connaissance scientifique en langue vernaculaire, en patois, en langue locale.
Si on prend “x” on mélange avec “y”, ça va bien donner ce que nous voulions obtenir, sauf que, entre-temps, il faut bien que nous nous rappelions de “z”; résidu de l’opération intermédiaire, qu’il va falloir juxter à “q”: ça donne 30 et ça confirme notre hypothèse. L’équation est donc résolue! C’est ainsi que dans les quartiers et autres faubourgs, en dehors de tout circuit officiel, foisonnèrent d’éminents Euclide et Pythagore qui dévoilaient au besoin les secrets mathématiques que l’enseignement officiel semblait voiler en utilisant l’usage de la langue des autres.
Certains groupes de répétition n’avaient même pas de répétiteur titulaire. C’étaient généralement des étudiants d’une même classe qui s’étaient auto-organisés. Lors des séances d’apprentissage, le plus fort en mathématique, celui qui avait tout compris à l’école, se levait et transmettait l’ontologie à ses camarades. 30 minutes plus tard, le voilà assis dans la masse des suiveurs, accroché aux lèvres de l’autre camarade expert en physique. Le jeu de rôle était tellement bien huilé que les discriminations de genre n’y avaient pas de place. Fille ou garçon, peu importait, ici c’était une question de knowledge, et tout le monde se conformait. L’objectif de tous, c’était de se doter des connaissances nécessaires pour passer les prochains examens de contrôle, passer le diplôme de fin d’année, réussir dans la vie.
On pourrait dire, sans être capable de le prouver, que la manifestation embryonnaire de ces centres auto-gérés de répétition a eu lieu vers les années 80, quand l’administration de notre pays semblait ne plus faire pour nous, mais contre nous. Ce qui semblait alors être seulement un effort collectif pour mieux comprendre les sciences est devenu, à mon sens, un acte de rébellion, si ce n’est de guérilla sémiologique. La langue, notre langue, c’était notre condition de sauvegarde. La langue des autres, il fallait l’apprendre, dans la mesure où nous maîtrisions la nôtre. Il y aurait dans ce discours, penseront d’aucuns, les germes d’un fondamentalisme dialectal. Ce ne serait pas mal vu en tout cas! Le monde n’est pas toujours juste. D’ailleurs, ces groupes que nous constituions, c’était pour nous secourir les uns les autres, sachant que nous étions appelés à nous suppléer, chacun à sa façon. C’était la solidarité.
 D’ailleurs, la langue de Molière dans laquelle on nous enseignait sans que nous n’y comprenions grand chose, comment les Français l’avaient-ils adoptée? Ne peut-on pas dire que, venant contrer l’incompréhensible Latin, elle fut elle aussi un instrument de résistance et de solidarité entre les personnes? Il en est ainsi de toutes les langues, oserais-je dire au prix de me faire passer pour Hermogène qui dans le Cratyle de Platon, se veut le promoteur d’un conventionnalisme linguistique à tout casser. Eh oui, en algèbre, le mot « facteur » n’a rien d’intrinsèquement numérique. On peut alors accepter qu’en ghomala, lors de la multiplication, on puisse le personnifier en le nommant « ndoh », c’est-à-dire le mari des autres nombres. C’est d’ailleurs un mari qui a l’air actif et fécond. Écoutez ceci : si « x », se mariant avec 3 nous restitue un résultat égal à 18, alors, les gars, « x » est, à lui tout seul, l’équivalent de 6. C’est-à-dire 6 x 3 = 18, comme nous disait le professeur.
D’ailleurs, la langue de Molière dans laquelle on nous enseignait sans que nous n’y comprenions grand chose, comment les Français l’avaient-ils adoptée? Ne peut-on pas dire que, venant contrer l’incompréhensible Latin, elle fut elle aussi un instrument de résistance et de solidarité entre les personnes? Il en est ainsi de toutes les langues, oserais-je dire au prix de me faire passer pour Hermogène qui dans le Cratyle de Platon, se veut le promoteur d’un conventionnalisme linguistique à tout casser. Eh oui, en algèbre, le mot « facteur » n’a rien d’intrinsèquement numérique. On peut alors accepter qu’en ghomala, lors de la multiplication, on puisse le personnifier en le nommant « ndoh », c’est-à-dire le mari des autres nombres. C’est d’ailleurs un mari qui a l’air actif et fécond. Écoutez ceci : si « x », se mariant avec 3 nous restitue un résultat égal à 18, alors, les gars, « x » est, à lui tout seul, l’équivalent de 6. C’est-à-dire 6 x 3 = 18, comme nous disait le professeur.
Martin, Susane, Gilbert, Apollinaire, Cécile, Jacques… Ce sont certains de mes camarades qui ont laissé l’école trop tôt, parce que ne comprenant pas bien la langue de Molière. Si on leur avait enseigné au moyen de notre Ghomálá, il y a longtemps que Martin, en particulier, aurait reçu le prix Nobel de la zoologie. Lui qui savait parfaitement, depuis notre tendre enfance, la variation des repas, l’heure de consommation et de sieste, les cris d’amour et de peine des rats et des hérissons. À la différence des mauvais chasseurs qui tuaient brutalement leur gibier, Martin, le précurseur naturel de l’animalisme, savait très bien comment le capturer vivant, sans le traumatiser. Des antilopes, des perdrix, des hérissons, des rats de brousse. Il leur parlait presque dans leur langue pour mieux les approcher et les capturer. C’est sans doute pour cela qu’il avait mentionné sur sa fenêtre « les beaux jours sont rats », confondant rare et rat! D’ailleurs, lors de son examen de certificat d’études primaire et élémentaire, fait en français, il fut envoyé à un tableau pour écrire une phrase. Après maints hurlements nasalisants de l’examinateur, exhortant à écrire « l’exode rural » au tableau, c’est avec bien de la cohérence que Martin écrivit « l’exode du rat », d’où son surnom, le ratologue!
Si la science avait été ouverte, il aurait été reconnu comme le meilleur zoologue, ce qu’il était exactement. Sauf que là, il n’y a plus que moi pour vous en parler!