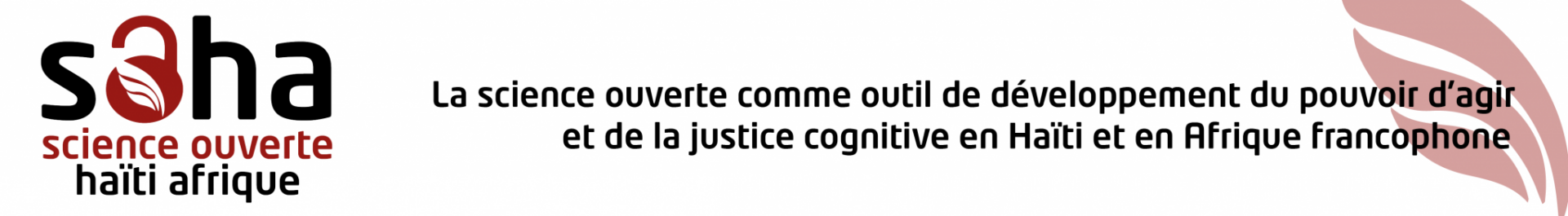Auteure : Clémence Chantal Ouedraogo
Auteure : Clémence Chantal Ouedraogo
Originaire du Burkina Faso, Clémence est doctorante en sociologie juridique à l’Université Lumière Lyon 2. Sa thèse porte sur l’exportabilité des droits de l’Homme et l’utilisation des outils juridiques et conceptuels occidentaux en Afrique de l’Ouest appliquée à la lutte contre les inégalités et les discriminations au Burkina Faso. Elle est diplômée d’un master en droits de l’homme, d’un master en lutte contre les inégalités et les discriminations et d’une maitrise en droit des affaires. Elle est également présidente de l’association des Graduate Women du Burkina Faso. Pour lui écrire : oooclemence@gmail.com
***
La principale question que pose ce billet est celle-ci : pourquoi faut-il exporter dans les institutions africaines des outils construits sur des réalités occidentales ? Les réalités et les valeurs culturelles africaines « positives » ne sont-elles pas à même d’inspirer des définitions, des conceptualisations, des lois ? Comme l’affirme Raymond Aron[1] dans Démocratie et totalitarisme (1965, p. 54) : « dans chaque société, les institutions doivent être adaptées aux particularités d’une constellation historique singulière ».
Lorsque le droit positif d’un pays construit ou adopte un mécanisme juridique étranger sans prendre le temps de l’adapter à ses réalités et légifère sans définir le sujet, cela engendre une cacophonie qu’il faut analyser. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la législation du Burkina Faso ne définit nulle part la notion de « discrimination » alors que le pays a adhéré à la majorité des instruments internationaux de lutte contre les discriminations[2] et mentionne la très célèbre règle de droit « Tous les hommes naissent libres et égaux » au 1er article de sa Constitution. L’irréalisme prend moins de sens lorsque l’on sait que la définition de la discrimination par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est identique mot pour mot à celle donnée par le Code Pénal français (art 225-1)[3]. Il n’y a pas d’adaptation aux réalités africaines. Par exemple, la discrimination en raison de l’albinisme[4] n’y a pas été intégrée, quand bien même le respect des droits fondamentaux des personnes albinos peut être en jeu dans plusieurs pays comme le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.
Ensuite, certains pays ont la fâcheuse tendance à « mal plagier les outils » occidentaux; la politique burkinabé et africaine de lutte contre les discriminations en général semble graviter autour de ce qu’on pourrait qualifier de « phénomène à la mode ». Alors que la France par exemple, se refuse à hiérarchiser les discriminations selon leur degré d’importance, il semble que le Burkina Faso le fasse selon des critères qui sont en fait subventionnés par les pays occidentaux ou les institutions internationales.
Pour finir, les pouvoirs publics s’occupent peu des nombreuses questions liées aux droits de la personne qui sont alors laissées à des initiatives privées. Le Burkina Faso est le pays de l’Ouest africain qui compte le plus grand nombre d’associations et d’ONG[5]. Les pouvoirs publics adoptent davantage une attitude de médiation que de règlementation et de pénalisation. Par exemple, au Burkina Faso, on note l’existence de violences sur les femmes âgées que l’on accuse de « sorcières » dans les villages. Elles sont bannies et dépossédées de leurs biens. Cette situation est intéressante sociologiquement, car ni l’histoire, ni les témoignages ne mentionnent qu’un homme ait été accusé d’être « sorcier » dans les mêmes conditions. Des enquêtes ont montré qu’il peut s’agir de techniques machiavéliques utilisées pour écarter des témoins gênants de viols et d’inceste. Cependant, il n’existe pas de réglementation, ni de pénalisation de tels agissements. La gestion des conflits passe par la médiation en général. Les femmes rejoignent des centres et sont prises en charge par des particuliers ou des associations[6]. Mais « les conventions sans le glaive ne sont que des paroles » (Hobbes, Le Leviathan).
Pour rentrer au coeur du questionnement sur l’exportabilité des droits de l’Homme, prenons comme exemple la question des femmes qui, de façon culturelle, ont une position « mitigée » au sein des sociétés africaines.
La place de la fille/femme africaine dans la société des hommes
On pense communément que la tradition africaine ne fait pas de place aux femmes et aux filles. Cela expliquerait que les filles aient été les plus exposées à l’analphabétisme et reléguées aux tâches ménagères, alors que les garçons étaient naturellement scolarisés. Cela expliquerait aussi que le fait que les balafres[7] soient en général beaucoup plus larges chez les femmes que chez les hommes et l’existence des mutilations génitales féminines, normalement interdites et réprimées par le Code pénal burkinabé depuis 1996 (art. 380 à 382). Malgré cette réputation de machisme, il existe de nombreuses figures féminines influentes, gouvernantes et guerrières ayant écrit l’histoire de nombreuses sociétés africaines parmi lesquelles Yennenga (princesse burkinabè du 12è siècle, redoutable amazone et générale de l’armée), Abbla Pokou (princesse et prêtresse ashanti ayant créé le peuple baoulé de Côte d’Ivoire), Ndete Yalla (reine du Waalo Sénégal), Naga (chef des amazones du Dahomey/Bénin), Dona Béatrice Kimpa Vita (prophétesse kongo au Congo), la reine de Saba (Éthiopie) et Nzinga (reine du Royaume de Ndongo et du Royaume de Matamba dans l’actuel Angola). Si les femmes n’avaient aucune place reconnue dans ces sociétés, ces reines et princesses ne devraient pas avoir pu laisser des traces dans l’histoire. L’arbre à palabres sous lequel étaient véhiculées les connaissances et l’essence de la société africaine n’était-il pas inaccessible aux femmes? Ce sont donc des hommes qui ont transmis aux futures générations une histoire dont les figure principales furent, à certains moments, des femmes. Qu’est ce qui explique ces contradictions? Beaucoup d’éléments appellent une déconstruction profonde de l’exportation des concepts occidentaux en Afrique, comme peut le suggérer notre second exemple.
L’utilisation du salaire de la femme burkinabè dans le foyer
En France, le mode général de fonctionnement des foyers est celui de la participation financière de chacun, souvent proportionnellement au salaire ou par moitié des charges. Au Burkina Faso, et dans l’ouest africain en général, le fonctionnement traditionnel des foyers est tout autre : si l’homme reconnaît qu’il est le « chef de famille », il assume sa position en principe jusqu’à la gestion de la bourse. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, c’est l’homme qui doit payer la dot et fournir la maison; ce n’est pas une obligation, mais une question d’honneur. L’homme doit s’occuper de toutes les charges du foyer (enfants, alimentation, soins, logement, eau, électricité, loisirs) et des besoins de sa femme/compagne : moyen de transport (vélo, voiture, moto), dressing, coiffure, loisirs. Un homme « vrai » doit être capable de subvenir à tous les besoins de sa famille (voire de sa belle-famille), peu importe si sa conjointe a des revenus. En revanche, la femme a le droit de faire usage de ses revenus selon son bon vouloir (cadeaux à son conjoint, à ses enfants, à ses parents et beaux- parents, décoration de sa maison, épargne, investissement). Le travail domestique, par contre, est laissé en principe à la femme, mais cela n’empêche pas que l’homme y participe. Le principe était pensé dans le sens d’un partage égalitaire. Dans les couples modernes, la femme, qu’elle ait une activité professionnelle ou pas, embauche une aide à domicile, mais dans les couples plus traditionnels, elle préfère s’en occuper personnellement.
Dans un tel contexte, l’écart des salaires entre hommes et femmes a un sens différent par rapport à la France. Le taux de répartition des tâches ménagères, tel que connu en France, a également un sens différent avec ce modèle de fonctionnement du Burkina. Même si des excès se transforment en abus sur certaines femmes, la situation de la femme burkinabé selon ce tableau semble plus reluisante que celle de la femme active française qui doit participer à la tenue du foyer en faisant plus de tâches ménagères que l’homme tout en contribuant financièrement.
Cette illustration nous montre toute la complexité des différentes traditions des peuples. Tout d’abord, le rôle social des hommes burkinabè leur attribue un égo démesuré qui tend à installer les femmes dans un confort facile. Il est légitime de se demander si la dépendance financière des femmes n’engendre pas plus un manque de respect de la part des hommes que leurs préjugés sur le sexe faible. Ne faut-il pas nuancer le sexisme dont on taxe généralement les sociétés africaines et mettre en lumière la répartition consensuelle tacite, verbale ou traditionnelle, des responsabilités? Ces situations nécessitent une réappropriation de la notion même d’égalité au sein de la société burkinabè, une déconstruction des concepts et une décolonisation des imaginaires. Il reste à savoir si le modèle traditionnel est à ce jour encore accepté et si les jeunes générations sont prêtes à le poursuivre.
L’expérience du Bureau International du Travail en matière de lutte contre le travail des enfants
Le Bureau International du Travail a longtemps expérimenté des échecs dans son projet IPEC : (International Programme on the Elimination of Child labour). Pourquoi? Les recherches ont mis en lumière un paradoxe. Le BIT utilisait le paradigme de « l’enfant à l’école » de manière tellement prégnante que « l’enfant qui travaille » était vu comme une exception. Pourtant, contrairement aux pays occidentaux, les enfants qui travaillent dans les pays des Suds constituent la majorité de la population d’âge scolaire; être au travail est la norme[8]. Même arrachés au monde du travail pour être envoyés à l’école, ils reprennent rapidement le chemin du travail. Cette lutte pour les scolariser n’a produit des résultats durables que lorsque le BIT s’est réellement penché sur la réalité et a compris que les enfants travaillaient en général pour la subsistance de leur famille, d’un parent défaillant, ou pour payer leur scolarité. Les seuls revenus assurant la survie de la famille proviennent d’eux. La solution trouvée par le BIT a été d’aider les parents à développer et à maintenir une activité génératrice de revenus qui puisse permettre aux enfants de retourner à l’école, et quelquefois d’aider ces derniers à exercer un travail sans mettre en péril leur santé, leur vie et leur éducation. Car le problème d’origine n’était pas le travail des enfants, mais plutôt le chômage ou le travail indécent de certains parents.
L’Afrique devra entreprendre une démarche d’inventaire de ses pratiques sociales, adapter à ses propres réalités les outils utiles pour penser l’égalité chez elle et s’affranchir des outils occidentaux non adaptés. Ne pas le faire serait suicidaire pour le système africain de développement. Je prépare des enquêtes sur ces questions au Burkina et en France que je partagerai dès que possible.
Notes
[1] Philosophe, sociologue, politologue, historien et journaliste français.
[2] Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de traités au niveau international et africain : la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination ; la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 28 novembre 1984 ; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée par l’OUA le 26 juin 1981, ratifiée le 06 juillet 1984 pour laquelle toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
[3] Code Pénal. Art. 225-1 « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L’alinéa suivant inclus aussi les personnes morales.
[4] L’albinisme est une maladie génétique héréditaire qui se manifeste par une absence partielle ou totale de pigmentation due à un déficit de production de mélanine. Cette anomalie génétique est mal perçue suivant les pays et les croyances. Les albinos sont souvent considérés comme arriérés et leur scolarité est parfois difficile (leur vue déficiente augmente la difficulté à suivre une bonne scolarité). Cette perception de la différence stigmatise les phobies : les albinos sont tour à tous considérés comme porteurs de malheurs ou bien idolâtrés. De nombreuses légendes persistent qui confèrent des caractéristiques mystiques aux personnes atteintes d’albinisme. Ces préjugés mènent au rejet de l’enfant albinos de la société (abandon de la mère, rejet du village, quolibets des camarades de classe…) mais dans certains pays l’ostracisme mène à des extrémités dramatiques. (juin 2013), Consulat du Burkina Faso de Nice.
[5] Le répertoire 2015 (http://www.dgcoop.gov.bf/index.php?) mentionne 394 associations/ONG humanitaires étrangères enregistrées, contre 150 associations et ONG étrangères et togolaises.
[6] La toute première maison à Ouagadougou par exemple a été financée par une religieuse.
[7] Une balafre est un signe ou un ensemble de signes d’appartenance à un groupe ethnique. Ce sont des scarifications sur le visage qui étaient pratiquées et qui sont en déclin certain depuis une vingtaine d’années.
[8] Bernard Schlemmer, « Le BIT, la mesure du “travail des enfants” et la question de la scolarisation », CAHIERS de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Hors-série n° 1 | 2005, 229-248.