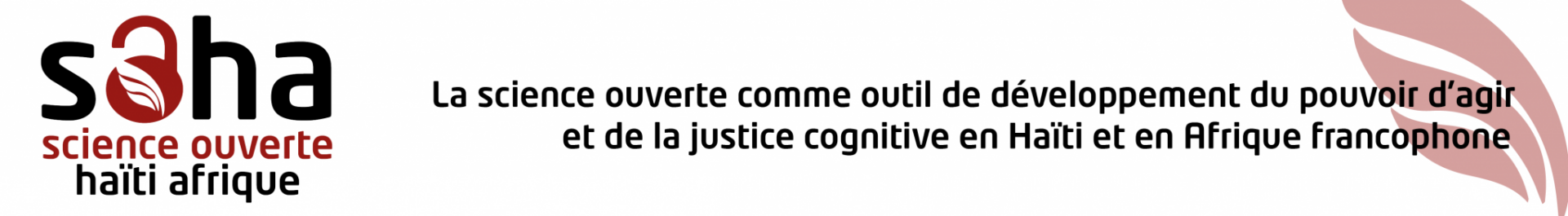Auteur : Hamissou Rhissa Achaffert, sociologue de l’éducation et du numérique, stagiaire à l’Institut de recherche en sciences humaines de Niamey et assistant de recherche du projet SOHA. Pour le joindre : hamissou1992@gmail.com
Résumé en Tamajeq:
Masnat’in koufar tatissawagharit digh tanagorate tolka masnaten win ghadnine ikan win kel tamajeq. Dagh cirow ta, aray a dassak ghi idinet san masnaten kul nasan, olane. Wur’in mikane as aghalak a dodmane san takarfirt id masnat’in koufar ofane wun kel tamajeq. Masnat intin ilissen ket nassan olane ghur masawsan.
Dagh cirow ta, i seknè oumouk wa siklan aghlak ilis id masnat in kufar. Odmane san ornane wunan.Ijilwa, aghalak yagot’nin ossofane a dishiwilan ilis wan takafirt i wan nassan. Ikin wurrin mikkane walan ka, fellas iliss wè wan kufar wurge wanana. Nikkini, tamajeq ai mossane ilis nana. Yimikan a ti tilmidan bararan digh lakol oumouk wa silimadan takafarte.
Iffè il misal’in masnat’in imagyaken id naden digh cirow ta. Aghalak wunni ilane masnaten yagot nine digh fel ichighilen nasane.
Yi mikkane, Alghikoumat a tassassaghrou bararan kel tamajeq digh ilis nasan. Yi mikkane ar wanda, a jat wasagrhou masnaten itene atarigh in kel tamajeq fel a jit wussine digh idinet.
Introduction
L’école coloniale a profondément déconnecté les jeunes Africains et Africaines de leur milieu culturel. En effet, aujourd’hui beaucoup de jeunes ignorent la richesse culturelle des communautés desquelles ils et elles proviennent. Cela est dû à l’écart énorme existant entre l’origine épistémologique des savoirs enseignés dans les institutions d’apprentissage et les réalités sociohistoriques des apprenants. En milieu universitaire, cela s’explique par l’hégémonie de la pensée occidentalo-centrée basée sur le positivisme qui ignore les savoirs locaux et les langues locales.
Ces savoirs locaux sont considérés comme relevant de l’expérience, de la sorcellerie ou de la magie. Or, dans tous les domaines dits scientifiques, l’expérience nourrit les savoirs. Les savoirs locaux se nourrissent aussi de l’expérience. Dans les sciences naturelles, c’est l’expérience qui permet de produire des connaissances. Dans le domaine des sciences sociales et humaines, l’expérience des individus est perçue comme étant porteuse de sens. C’est pourquoi dans les recherches, toute la latitude est donnée à la personne interviewée pour dire ce qu’elle pense de l’objet de la recherche, sauf dans les cas des études quantitatives, qui en réalité ne permettent pas de saisir le sens que les acteurs donnent à leur vécu.
Les pratiques éducatives dans les anciennes colonies basées sur l’inculcation de la pensée philosophique, sociologique et historique eurocentrée ont pour conséquence un décalage énorme entre les cadres de pensée et les réalités socioculturelles. En effet, cette pensée qui prend la forme des livres et des articles est survalorisée, au détriment de la pensée locale. L’évaluation elle-même se fonde sur la capacité à assimiler la pensée d’un auteur ou d’une autrice occidentale. Les mémoires et thèses en philosophie en sont un exemple très illustratif.
Cela implique que la colonisation que nous avons subie a engendré une épistémicide, c’est-à-dire une destruction des cadres épistémologiques locaux ou leur assujettissement à l’épistémologie occidentale. Ensuite, elle a provoqué le linguicide, c’est-à-dire la destruction et l’assujettissement de nos langues au profit des langues coloniales, à telle enseigne que certains colonisés ont plus honte de ne pas pouvoir parler ou écrire correctement la langue coloniale que leur propre langue.
Ainsi, ceux qui parlent et maitrisent la pensée occidentale sont perçus comme les remplaçants des colonisateurs, c’est-à-dire les savants, et les autres sont considérés comme des cruches vides à qui il faut tout apprendre.
Au cours d’une des conférences de Florence Piron, militante de la décolonisation des savoirs et de la justice cognitive à Niamey (Niger), un chercheur de l’institut de recherche en sciences humaines (IRSH) affirme ceci :
Si avant de créer l’université Abdou Moumouni de Niamey, les autorités avaient écouté cette conférence, notre université serait orientée vers les préoccupations locales et les savoirs locaux.
Dans sa conférence, Florence Piron veut montrer comment faire des universités des moteurs de développement local. Entre autres pistes, elle avait proposé d’inviter les universités postcoloniales à regarder vers l’intérieur, c’est-à-dire à valoriser les langues locales et les savoirs locaux, à prioriser les préoccupations locales dans les programmes et les sujets de recherche afin d’éviter d’être dans la logique du mimétisme et l’extraversion vers le nord. On peut penser au Niger que l’énergie solaire soit développée, car le professeur Abdou Moumouni était le précurseur nigérien de l’énergie solaire.
Les langues des communautés sont abandonnées au profit de la langue française pour le cas des anciennes colonies françaises et de l’anglais pour les anciennes colonies anglaises. Ces langues sont imposées dans l’écriture et la communication dans la sphère académique. Au niveau international, beaucoup de chercheurs et chercheuses se plient à l’anglais du fait de la domination symbolique qu’exerce le monde anglo-saxon dans le système science-monde de la publication scientifique (Piron et al. 2017). On observe ainsi une extraversion des universitaires vers le nord qui oriente leur modèle théorique de recherche, la langue de publication, les revues et les maisons d’édition.
Aujourd’hui, il est plus que nécessaire pour les universitaires africains en général, et du Niger en particulier, de revenir au village et dans les hameaux pour participer au dialogue des savoirs qui se tient au jour le jour dans ces communautés et de faire de la recherche pour le développement local durable en lien avec les préoccupations locales et en respectant les savoirs locaux. Ce dialogue des savoirs prend une autre forme dans le monde académique, marqué par la compétition et le cloisonnement entre chercheurs et différents domaines de recherche qui freine la circulation et le dialogue des savoirs.
Dans la ligne de la justice cognitive, il est urgent aujourd’hui de casser cette hiérarchisation des savoirs pour promouvoir la justice cognitive, c’est-à-dire la reconnaissance de l’existence d’une écologie des savoirs, d’une pluralité de savoirs qui ont la même valeur heuristique et dont il faut respecter l’origine socioculturelle et historique.
L’une des postures essentielles à la décolonisation des savoirs est celle qui consiste à « learning to unlearn in order to relearn » et de « rethinking thinking itself » (Ndlovu-Gatsheni 2018), c’est-à-dire à déconstruire ce qui nous a été inculqué relativement à la perception de l’existence des autres formes de savoirs (en dehors du savoir scientifique occidentalocentré qui est enseigné à l’université et à l’école conventionnelle), afin d’apprendre à apprendre auprès de nos grands-parents des savoirs localement utiles. Cette posture permet ainsi de nous remettre en cause et de repenser ce que nous sommes à l’origine et ce que nous sommes devenus aujourd’hui après avoir déployé toute notre énergie à apprendre et à penser comme le colonisateur. C’est pourquoi il est nécessaire d’aller au village pour réapprendre sa propre langue et d’ouvrir ses yeux, grâce à cette rupture épistémologique que je viens de décrire, pour découvrir les savoirs locaux.
C’est ce qui m’a amené à approcher les populations rurales pour comprendre comment elles analysent leur vécu et quels sont les savoirs dont elles disposent.
Ce billet de blog s’inscrit dans ma posture décoloniale du rapport au savoir et à la connaissance afin de lutter contre les injustices cognitives liées au mépris et à l’ignorance des savoirs locaux et des langues locales, mais aussi à contribuer à leur valorisation. Je vais présenter les savoirs des paysans chez les Haoussas et les forgerons et artisans de la communauté touarègue.
Les savoirs des paysannes et des paysans
Pendant les vacances passées, j’étais au village de Dan Damaou. C’est un petit village de quelque 300 habitants disposants d’une école, d’une case de santé et d’un château d’eau alimenté avec l’énergie solaire. La majorité de la population qui y vit est d’origine haoussa et exerce l’agriculture de subsistance et l’élevage intensif. Pendant la saison de pluie, hommes, femmes et jeunes prennent leurs outils pour aller au champ labourer la terre.
Une soirée, de retour des champs, des agriculteurs me trouvent à l’ombre d’un grand arbre pour me raconter ce qui se passe au champ. Ces paysans ne sont pas des agronomes ni des météorologues, encore moins des biologistes, mais ils observent de près l’évolution de leurs cultures et analysent les conditions climatiques auxquelles elles sont soumises. Ils n’ont pas de laboratoire d’analyse, mais ils sont constamment sur leur champ en travaillant la terre et en observant l’état de leur culture pour prendre des décisions sur les travaux futurs et surtout anticiper l’invasion des ennemis de cultures. Au cours de l’une de leurs discussions, l’un d’eux me dit ceci :
Cette année, il a beaucoup plu dans notre zone. J’ai remarqué que les cultures de mil sont saisies par la forte quantité de précipitation. S’il n’y a pas de rupture de pluie, il est fort possible que le mil ne grandisse pas. Cela peut avoir entre autres conséquences, que le mil ne produise pas une tige robuste et que l’épi ne soit pas gros du tout. Ce qui va engendrer une mauvaise récolte malgré la forte pluviométrie enregistrée.
Cela montre combien de fois ces paysans sont intelligents et doués de savoirs inimaginables que les agronomes ne peuvent pas comprendre à cause des murs épistémologiques de l’université qui les empêche de voir et de s’intéresser au local. Au lieu d’enseigner l’agronomie à un étudiant de licence qui va passer tout ce cycle peut être sans aller aux champs, il est essentiel d’aller au village, car les dépositaires des savoirs en agriculture sont là-bas. Ce sont eux qui vont enseigner aux enseignants chercheurs et apprendre aussi de la part de ces enseignants chercheurs des savoirs en agronomie qu’ils vont tester dans leur champ. Les étudiants vont apprendre ainsi auprès de leurs grands-parents dans leur langue respective. Ce dialogue de savoir est essentiel pour développer l’agriculture au Niger, car c’est la première activité économique du pays.
Dans ce village, les populations qui y vivent font appel à l’expertise des peulhs qui sont les éleveurs par excellence. Ce sont eux qui savent traiter les maladies des animaux, des consultants. Ce sont eux par exemple qui conseillent sur les types de plantes que les animaux doivent manger à telle ou telle période de l’année, pourquoi et quand donner du sel aux animaux. D’ailleurs, les populations ont plus confiance en ces éleveurs que dans les agents vétérinaires qu’ils accusent souvent de donner des mauvais traitements et de tuer leurs animaux.
Les savoirs des artisanes et des artisans
Dans la société touarègue, les jeunes hommes et femmes apprennent dès leur bas âge des savoirs localement indispensables pour toute la communauté. C’est essentiellement la couche des inadens, les forgerons et les artisans, qui s’occupent du travail de transmission des savoirs. Les hommes travaillent le fer et le bois pour concevoir les outils indispensables pour la communauté.
Ainsi, relativement au travail du bois, les hommes fabriquent entre autres :
Tedoubout (le lit comportant les piliers, les deux têtes du lit et les supports) Tèkarkart (la poulie)
Tchiokalen (les cuillères)
Imolane (les louches)
Alkada (Recipient traditionnel en bois)
Tchrikène (les selles de chameau qui sont de quatre catégories. Le Kantarki, la selle utilisée lors des déplacements, la Tahiass pour les petits voyages, la Takokeyte utilisée par la classe moyenne lors des festivités et les voyages, et la Tamzak qui est très bien ornée et qui n’est utilisée que lors des festivités de grande importance comme les cérémonies de mariage).
Igeydane (deux supports utilisés pour rassembler des couvertures et des tissus d’ornement de la tente d’une jeune mariée). Toutoungourte (les deux supports principaux du lit)
Tindé (le mortier)
Ezaghane (le pilon)
Les femmes, quant à elles, fabriquent des objets d’art destinés à l’ornement de la chambre de la jeune mariée ou l’ornement de certains objets comme la fabrication de la Tamzak qui nécessite un travail collaboratif entre l’artisan et sa femme. C’est la selle la plus précieuse ! Seuls les riches peuvent s’en procurer, car elle vaut un chameau.
En dehors de ce coup de pouce qu’elles donnent aux hommes, elles fabriquent entre autres :
Achakouwa (le deuxième objet d’embellissement le plus précieux d’un chameau utilisé lors des festivités et cérémonies. Il s’accroche à la selle du chameau)
Abewoune (l’objet d’embellissement du chameau le plus précieux. Il s’accroche à la selle du chameau).
Tilgame (Une corde en peau qui sert à attacher les couvertures rangées dans les Igeydanes) Tighrikène (les sacs qui s’accrochent à la tente d’une jeune mariée) Idifrane (Les coussins touaregs)
Tarèzime (La corde en peaux qui est utilisée pour conduire le chameau
Le travail de fer est essentiellement effectué par les hommes qui disposent chacun de son trousseau qui s’appelle Aloka. Chaque jeune forgeron dispose des variétés de marteaux et d’une enclume pour son travail. Ce travail permet de fabriquer entre autres :
Tizigiyaze (Les couteaux)
Tikobawène (Les sabres)
Akaskabou (Un outil d’embellissement du chameau qui se place sur sa tête)
Tchigimt (Un anneau qui se pointe à la narine d’un chameau et à laquelle on attache la Tarèzime qui sert à conduire le chameau) Etc.
Cela implique que dans la communauté touarègue, tous les savoirs utilisés dans l’artisanat sont utilisés pour répondre aux exigences culturelles et aux besoins sociaux. Les artisans travaillent au jour le jour pour répondre aux différentes demandes de fabrication des objets d’art. Ces objets sont donnés sous forme de cadeau ou sont vendus à un membre de la communauté qui en aurait besoin.
L’acquisition des savoirs et des compétences nécessaires à la fabrication de ces outils et objets très importants par la communauté se fait de manière ouverte, dans la collaboration et l’entraide mutuelle. Les artisanes par exemple font le travail collaboratif pour s’entraider lorsqu’il est nécessaire de finir un travail rapidement. Ces artisans n’ont jamais suivi des cours de géométrie, de physique ou de chimie pour comprendre comment superposer correctement les deux parties d’une selle ou pour savoir comment fondre le plomb ou le cuivre nécessaire au travail d’embellissement de la Tamzak.
Conclusion
Malheureusement, aujourd’hui ces savoirs sont relégués au second rang à cause de l’hégémonie de la pensée eurocentrée. La tente est remplacée par la maison en banco, le chameau est remplacé par la moto, les cuillères en fer inoxydables remplacent les cuillères en bois. Ces savoirs sont marginalisés au profit du savoir scientifique occidental.
Il est plus que nécessaire aux jeunes Africains et Nigériens en particulier de décoloniser leur pensée pour revaloriser le local et se libérer de l’invasion de l’industrie afin de conserver cette immense richesse culturelle dont disposent nos parents de la campagne. Cette décolonisation passe par l’utilisation des outils de nos artisans afin de contribuer au développement de l’économie locale. Elle passe aussi par la reconnaissance de leur savoir et de leurs compétences au même titre que les savoirs industriels qui nous abîment aujourd’hui.
Se décoloniser ne signifie pas de rejeter les savoirs occidentaux et les langues coloniales, mais plutôt de les considérer au même titre que les savoirs locaux et les langues locales dans le souci de la justice cognitive.
La société touarègue (Tifinagh) dispose de son propre alphabet d’écriture que quelques personnes utilisent encore pour saisir les
noms des contacts ou des messages, mais qui n’est pas du tout maitrisé par les jeunes. Pour faire justice cognitive à ce peuple, l’État nigérien a l’obligation d’enseigner aux enfants de cette communauté dans leur propre langue et en utilisant cette écriture. L’État aussi doit créer des centres d’apprentissage de ces métiers d’arts et d’artisanats pour vulgariser les savoir-faire des artisans et des artisanes du Niger en général.
Dans la sphère scientifique, il est important d’aller vers cette rupture épistémologique pour assurer un meilleur ancrage culturel et linguistique de nos productions scientifiques.